par Dominique IOGNA-PRAT
Religions & Histoire HS N°3
L'allusion qui a été faite précédemment à la pastorale de l'écrit, à la présence au monde des renonçants par l'écrit, invite à aborder le problème de la place des lettres dans le modèle monastique clunisien, confondu en l'espèce avec le monachisme bénédictin traditionnel.
Éloge de la sainte ignorance...
Le paradoxe veut que le moine, prototype du lettré en Occident, est d'abord attiré par la sainte ignorance dont l'exemple est donné par une série de saintes figures féminines, à commencer par Marie Madeleine, l'apôtre des apôtres, qui la première a eu la révélation alors qu'elle est la plus ignorante des disciples du Christ. Avec la Madeleine, le moine d'Occident justifie son propos d'avoir raison seul, serait-ce contre tous, et, ce faisant, d'éviter à l'Église de sombrer ; il incarne une forme de « personnalisme » chrétien, qui est un aspect capital de l'ecclésiologie médiévale.
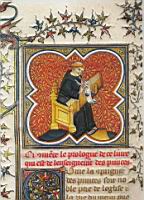
Moine copiste, illustration d'un traité philosophique et moral, École française, XIVe siècle, Besançon, Bibliothèque municipale. @ Aisa / Leemage
... mais pratique de l'érudition
La sainte ignorance de celui ou celle qui est directement illuminé(e) par l'Esprit et qui, dans la logique des mystiques, emprunte la « voie courte » pour accéder à Dieu et faire retour à l'Un, est contrebalancée par des formes institutionnalisées d'enseignement du sacré qui supposent d'emprunter la « voie lente » du lettré. Pour paraphraser le titre d'un classique en matière d'érudition bénédictine — L'amour des lettres et le désir de Dieu, de dom Jean Leclercq (Paris, Cerf, 1957) —, le « désir de Dieu » passe, dans l'Occident médiéval, par l'amour des lettres qui sont une nécessaire propédeutique (1) pour s'agréger à la communion des saints et accéder à la vision directe de Dieu, un peu comme si, dans une religion du livre, l'idéal de réalisation personnelle qu'incarne le moine ne pouvait se faire qu'en cheminant méthodiquement dans l'univers des signes porteurs de la Révélation. Dans ces conditions, le moine est nécessairement érudit parce que le texte sacré est la porte d'accès à la sagesse divine. D'où l'importance de la lectio diuina dans le monachisme bénédictin, qui place la méditation solitaire des Écritures (Bible, exégèse des Pères, homélies et Vies de saints) et leur pratique communautaire dans le cadre des heures au centre de la vie conventuelle.
Quand l'Église conservait et diffusait les lettres
La valorisation du moine lettré au Moyen Âge tient en bonne partie au destin même des lettres dans l'Occident latin après la chute de l'Empire romain. Sur fond d'hellénisation (dès le IIe siècle) puis d'insertion profonde dans la latinité (essentiellement aux IVe et Ve siècles), le christianisme devient, en tant que religion de l'État romain (à l'extrême fin du IVe siècle), un vecteur essentiel dans la vie des lettres antiques et de leur diffusion au-delà du monde romain, au gré des avancées du prosélytisme chrétien. Lorsque, avec la chute de l'Empire romain, l'Occident latin se morcelle et se balkanise, l'Église demeure un pôle actif de vie culturelle ; c'est le cas, bien sûr, des cités et des grandes figures d'évêques lettrés, tel Ambroise à Milan ou Augustin à Hippone ; c'est aussi le cas de grandes communautés de moines, par exemple Vivarium, dans le Sud de l'Italie, que fonde Cassiodore (vers 485 -vers 580) et qui, dans le rassemblement de manuscrits et la traduction de textes grecs en latin, assume le rôle d'un véritable conservatoire antique. À l'extrême opposé, au Nord-Ouest de l'Europe, dans un monde tardivement gagné au christianisme et, par lui, aux lettres antiques, les moines insulaires, spécialement les moines irlandais, assurent un rôle étonnant de préservation puis de retransmission des lettres grecques, en particulier Platon et les platoniciens chrétiens. Le problème que posent ces « conservatoires » antiques, surtout s'il s'agit d'écarts saints comme les monastères,, est de savoir à quelles lettres se référer dans l'héritage gréco-latin : la Bible et ses commentaires ou les lettres profanes ? Songeons au cauchemar de Jérôme, ce grand lettré latin qui gagne la Terre du Christ en Palestine pour se vouer à Dieu seul et à son enseignement en traduisant la Bible en latin : « Suis-je chrétien ou bien cicéronien ? » En écho, Odon de Cluny a parlé du « venin » des vers de Virgile. Dans ces conditions, on comprend que lorsque les souverains carolingiens entreprennent de restaurer la souveraineté impériale en puisant dans le souvenir antique de Rome, ils s'alimentent en classiques (César, Suétone, une partie de Tite-Live) qu'ils trouvent en bonne partie dans les bibliothèques monastiques. C'est toute cette tradition que Cluny capitalise dans sa formidable bibliothèque, connue par un catalogue du milieu du XIe siècle, qui s'est constituée sur la base du fonds (largement carolingien) des ouvrages apportés par Odon.

Deux moines discutant ou scène de cours, miniature tirée de De la nature des choses de Raban Maur, IXe siècle, archives de l'abbaye de Mont-Cassin. © Luisa Ricciarini / Leemage
Le monastère, centre d'enseignement
Dans les grandes communautés de moines, aux fonctions scripturaires que la politique religieuse des souverains carolingiens (spécialement Louis le Pieux et ses successeurs) tend à uniformiser par l'adoption généralisée du modèle bénédictin, s'ajoute un rôle de centre d'enseignement, comme le suggère le fameux plan de l'abbaye de saint Gall, qui représente le monastère idéal de la réforme carolingienne et qui comporte une école extérieure. Le qualificatif « extérieure » suppose que l'école accueillait, outre les oblats ou enfants confiés à ses soins pour y devenir moines, un nombre variable de laïcs issus de la grande ou moyenne aristocratie. Cluny, comme tout monastère bénédictin traditionnel, est donc un véritable centre d'enseignement où l'on s'initie aux premiers des arts libéraux regroupés au sein du triuium (grammaire, rhétorique, dialectique), puis au quadriuium (arithmétique, géométrie, musique, astronomie) qui reste, sauf exception rarissime, l'apanage des lettrés, c'est-à-dire des moines. D'où la coloration très fortement monastique des lettres divines jusqu'à l'âge des écoles urbaines (XII' siècle), puis de l'Université (Xllle siècle), spécialement l'exégèse et la théologie, dont l'héritage pèse lourd dans la formation des clercs à l'âge de la réforme de l'Église. des moines lettrés — entre autres des clunisiens — dans cette réforme et On comprend, dès lors, la présence dans la pastorale monastique de l'écrit qui l'accompagne.

Des enfants sont confiés aux moines pour qu'ils en assurent l'éducation, miniature tirée du Code Justinien, 1350, Césène, Biblioteca Malatestiana. Luisi Riccianni / Leemage
La « bureaucratisation du monachisme »
Au titre des travaux d'écriture des moines, on ne saurait pourtant s'en tenir aux seules productions théoriques. Dans l'explosion documentaire contemporaine du premier âge féodal (880-1050), les écrits pratiques des moines (règles, coutumiers, cartulaires) représentent une contribution considérable sur laquelle il convient d'autant plus d'insister que c'est dans les monastères que se forgent alors quelques-uns des rouages de la bureaucratie ecclésiastique, préfiguration du premier appareil de l'État moderne. C'est ainsi que la première chambre des comptes est fondée à Rome, dans la seconde moitié du XIe siècle, suivant les usages clunisiens et par un technicien clunisien, Pierre Gloc. Bel exemple de ce que Max Weber a qualifié de « bureaucratisation du monachisme » à l'âge de l'élaboration institutionnelle de l'Église.
Propédeutique : caractère facilitateur d'un savoir ou d'un processus d'acquisition de savoirs pour l'acquisition de savoirs ultérieurs. Période d’enseignements, mise en place dans certaines écoles, universités, séminaires, etc, visant à préparer l’élève pour de futurs enseignements, et visant à faciliter l’apprentissage.
Retour
Moine copiste, illustration d'un traité philosophique et moral, École française, XIVe siècle, Besançon, Bibliothèque municipale. @ Aisa / Leemage
Deux moines discutant ou scène de cours, miniature tirée de De la nature des choses de Raban Maur, IXe siècle, archives de l'abbaye de Mont-Cassin. © Luisa Ricciarini / Leemage
Des enfants sont confiés aux moines pour qu'ils en assurent l'éducation, miniature tirée du Code Justinien, 1350, Césène, Biblioteca Malatestiana. Luisi Riccianni / Leemage